En 2000, la revue The Economist qualifiait l’Afrique de « continent sans espoir » : celle-ci connaissait depuis plusieurs décennies une très faible croissance, alors même que les revenus moyens de ses habitants étaient plus faibles que sur les autres continents, notamment l’Asie de l’Est ou l’Amérique latine. Pourtant, les pays africains ont connu par la suite une période de forte croissance économique. Non seulement les taux de croissance moyens ont été positifs pour la première fois depuis plusieurs décennies et certaines des économies africaines ont même connu une croissance supérieure à plus de 6 % par an, mais les taux de croissance ont pu en outre être sous-estimés. Parallèlement, toujours à partir du tournant du siècle, la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté et le taux de mortalité infantile ont fortement diminué, tandis qu’une part croissante de la population accédait à l’éducation. Bref, au cours de ces dernières décennies, nous avons été les témoins d’un véritable « miracle de la croissance africaine » et, pour l’heure, celui-ci se poursuit.
Cette accélération de la croissance économique en Afrique pourrait résulter de la transformation structurelle que connaît le continent. En effet, plusieurs études ont suggéré que l’agriculture constituait le secteur d’activité le moins productif de l'économie ; ce serait d'ailleurs particulièrement le cas en Afrique. Par conséquent, lorsque l’emploi et l’activité productive sont réalloués du secteur agricole vers l’industrie et les services, alors la productivité des travailleurs augmente mécaniquement et la croissance économique tend à s’accélérer. C’est pour cela que Margarita Duarte et Diego Restuccia (2010) ou encore Berthold Herrendorf, Richard Rogerson et Ákos Valentinyi (2014), par exemple, ont pu récemment affirmer que ce changement structurel constituait une caractéristique fondamentale de la croissance économique. Beaucoup jugent toutefois que les niveaux de productivité et les gains de productivité sont plus faibles dans le tertiaire que dans l’industrie, or la part de l’emploi de l’industrie n’augmente pas indéfiniment : à partir d’un certain niveau de développement, elle amorce son déclin. Par conséquent, une économie a beau continuer à se tertiariser, sa croissance risque de ralentir lorsque s’amorce sa désindustrialisation.
Par conséquent, selon Xinshen Diao, Kenneth Harttgen et Margaret McMillan (2017), si des pays à différentes étapes de développement tendent à ne pas présenter la même structurelle sectorielle, l’écart de niveau de vie que les pays africains vis-à-vis des autres pays pourrait s’expliquer par le fait que les premiers ne se situent pas à la même étape de développement que les seconds. Ils ont alors cherché à relier l’accélération de la croissance économique et la baisse de la pauvreté que les pays africains ont récemment connues aux transformations structurelles qui sont à l’œuvre en leur sein. Ils constatent qu’une grande partie de cette croissance et de cette réduction de la pauvreté s’explique effectivement par un fort déclin de la part de la main-d’œuvre employée dans le secteur agricole, donc par la hausse de la part des actifs employés dans l’industrie et le tertiaire.
Dans l’échantillon de neuf pays à bas revenu que Diao et ses coauteurs analysent, ils observent que la part de la population active employée dans l’agriculture (qui était en particulièrement élevée dans les années quatre-vingt-dix) a baissé en moyenne de 9,33 points de pourcentage entre 2000 et 2010, tandis que la part de l’emploi dans l’industrie augmentait de 1,46 point de pourcentage et que la part de l’emploi dans le tertiaire augmentait de 6,13 points de pourcentage. Le déclin de l’emploi agricole a été le plus prononcé parmi les femmes du milieu rural âgées de plus de 25 ans qui ont bénéficié d’un enseignement primaire. Il a été accompagné par une hausse systématique de la productivité du travail, dans la mesure où la réallocation de la main-d’œuvre s’est effectuée d’un secteur à faible productivité (l’agriculture) vers des secteurs à plus forte productivité (l’industrie et le tertiaire). Dans l’échantillon de pays qu’ils étudient, la productivité du travail s’est accrue au rythme moyen de 2,8 % par an entre 2000 et 2010 ; 1,57 point de pourcentage de cette croissance s’explique par le changement structurel. Par contre, entre 1990 et 1999, la croissance de la productivité du travail était proche de zéro et le changement structurel tendait en fait à freiner la croissance économique. Lorsque Diao et ses coauteurs se penchent sur un échantillon de pays africains à plus hauts revenus, ils constatent que ces derniers ont connu la même accélération de la croissance de leur productivité du travail, mais les concernant l’ensemble de cette croissance s’explique par la croissance de la productivité intra-sectorielle.
Diao et alii ont notamment comparé le niveau des parts sectorielles de l’emploi en Afrique avec celui observé dans les autres pays, en prenant en compte le niveau de revenu. Ce faisant, ils remarquent qu’au vu des niveaux de revenu par tête en Afrique, les parts respectives de l’agriculture, de l’industrie et du tertiaire correspondent assez bien à ce que l’on peut s’attendre en observant ce qu'on pu connaître les autres pays par le passé. En outre, bien que la part de l’industrie dans l’emploi ne s’accroisse pas rapidement, cette part n’a pas atteint son pic dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne et elle continue de s’accroître.
La forte croissance que l’Afrique a connue ces dernières décennies n’est donc pas due (seulement) à des facteurs conjoncturels, comme par exemple la hausse des prix des matières premières, mais elle tient (également) à des facteurs structurels. Diao et ses coauteurs se montrent ainsi optimistes quant à la poursuite de la croissance en Afrique : tant que le changement structurel se poursuit et surtout que la part de l’emploi industriel n’a pas encore atteint son pic, la croissance africaine va se poursuivre. Toutefois, certains comme Dani Rodrik (2015) ont pu remarquer qu’à mesure que le temps passe, la part de l’industrie tend à atteindre son maximum de plus en plus tôt, relativement au niveau de vie : les pays en développement feraient aujourd’hui face à une « désindustrialisation précoce » (premature deindustrialization) par rapport aux pays qui ont amorcé leur développement plus tôt. Autrement dit, les pays africains risquent de ne pas profiter autant de l’industrialisation que n’en ont profité les autres pays.
Références
RODRIK, Dani (2015), « Premature deindustrialization », NBER, working paper, n° 20935, février.
commenter cet article …






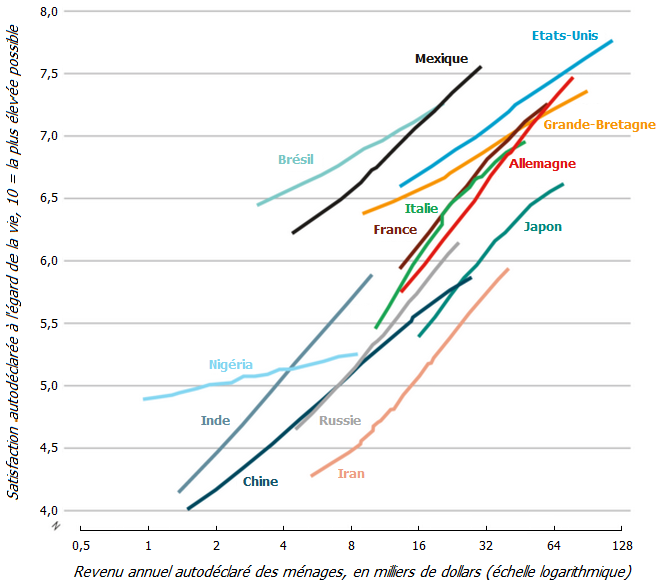
/image%2F1455320%2F20160828%2Fob_7355b6_jesse-pinkman-illusio-3.jpg)