A long terme, l’évolution de la production par tête et la progression du revenu par habitant dépendent directement de la main-d’œuvre employée, du montant accumulé de capital physique et humain et de la technologie disponible. Pourtant, la présence de travailleurs qualifiés ou l’abondance en ressources naturelles ne suffisent pas pour générer de la croissance. Les institutions pourraient être une cause plus fondamentale de la croissance économique en influençant l’accumulation des facteurs et le progrès technique. Selon Douglass North (1990), « les institutions sont les règles du jeu dans une société ou, plus formellement, elles sont les contraintes humainement conçues qui façonnent l’interaction humaine, que celle-ci soit politique, sociale ou économique ». Les institutions déterminent comment les ressources économiques et le pouvoir politique sont répartis entre les différents individus et groupes composant une société, ce qui a deux implications majeures [Acemoglu et alii, 2005]. D’une part, c’est notamment à travers cette répartition que les institutions économiques exercent une fonction incitative sur les comportements économiques et façonnent la trajectoire même de la croissance économique : elles influencent l’investissement des agents dans l’accumulation du capital physique et humain et dans l’activité d’innovation, mais cette influence peut aussi bien être positive que négative. D’autre part, puisque les institutions déterminent justement la répartition des ressources économiques et du pouvoir politique, la définition du cadre institutionnel est l’objet de lutte entre les différents groupes, chacun d’entre eux cherchant à imposer les institutions qui lui sont les plus favorables. C’est l’issue même de cette lutte qui va alors déterminer si le cadre institutionnel va en définitive influencer positivement ou négativement le potentiel de croissance de l’économie.
Dans leurs multiples travaux, Daron Acemoglu et James Robinson font la distinction entre les institutions inclusives et les institutions extractives ; seules les premières sont favorables à la prospérité du pays, tandis que les secondes étouffent l’activité entrepreneuriale. Les institutions sont dites inclusives lorsqu'elles contraignent le pouvoir pouvoir politique et que le système des droits de propriété profite à une majorité de la population, c’est-à-dire lorsque la majorité des agents peuvent alors s’approprier les fruits de leurs investissements et plus largement espérer obtenir une part des richesses produites dans l’économie. Lorsque l’accès à l’éducation est ouvert à tous et lorsque le système de protection de la propriété intellectuelle est suffisamment élaboré, les entrepreneurs profitent alors de la diffusion des connaissances et se lancent dans l’activité d’innovation, ce qui permet ainsi à l’économie de se rapprocher de la frontière technologique. En revanche, les institutions sont dites extractives lorsque le système des droits de propriété ne bénéficie qu’à une infime fraction de la population. Les sociétés où les institutions extractives prédominent seront susceptibles de connaître une stagnation économique. En effet, l’élite délaissera les activités innovantes pour se vouer à la seule quête de rentes (rent-seeking). Elle cherchera notamment à promouvoir les institutions qui perpétuent les inégalités de richesse et reproduisent le partage actuel du pouvoir. Tant qu’une minorité s’accapare la majorité des fruits de la croissance, le reste de la population ne sera pas non plus incitée à se lancer dans l’entrepreneuriat et l’innovation.
Les différences institutionnelles observées d’un pays à l’autre peuvent alors expliquer pourquoi certains pays expérimentent des taux élevés de croissance, tandis que d’autres connaissent une stagnation économique, voire tombent dans une trappe à pauvreté. L’hétérogénéité institutionnelle expliquerait notamment pourquoi la Révolution industrielle s’est déroulée dans l’Angleterre du dix-neuvième siècle : celle-ci aurait profité de son avance institutionnelle sur les autres pays, notamment en renforçant les droits de propriété. Le système des brevets fut notamment introduit en 1624. Alors qu’elle ne disposait pas de compétences techniques plus élevées, l’Angleterre a su ainsi adapter ses institutions formelles aux besoins changeants de l’économie.
On peut ainsi relier l’avantage comparatif de l’Angleterre dans la production de biens manufacturés avancés à son cadre institutionnel. Nathan Nunn et Daniel Trefler (2013) ont observé comment le cadre institutionnel d'un pays peut façonner ses échanges extérieurs. Dans leur optique, les institutions domestiques peuvent constituer une source d’avantage comparatif dans le commerce international, et ce sans même forcément influencer directement les dotations factorielles ou non. Afin de montrer l’importance des institutions formelles, Nunn et Trefler considèrent la production d’un avion de ligne commercial. Sa production nécessite d’importants efforts d’innovation de la part de toutes les parties impliquées dans la transaction. Puisque ces efforts peuvent difficilement être observés dans un cadre légal et que l’innovation est par définition soumise à l’incertitude, les parties prenantes ne peuvent souscrire qu’à des contrats incomplets. A l’inverse, un produit standardisé tel que le jeans n’exige pas d’intrants spécifiques à sa production et les tâches de fabrication peuvent facilement faire l'objet de contrats. Par conséquent, un pays disposant de bonnes institutions contractuelles et d'un système élaboré de brevets va avoir des coûts relativement faibles dans la production d’avions et des coûts relativement élevés dans la production de jeans. Outre les institutions contractuelles et les droits de propriété, les institutions financières sont également une source d'avantage comparatif. Par exemple, les industries faisant face à des coûts fixes importants doivent avoir accès à des financements extérieurs, or ce financement sera moins coûteux si les investisseurs extérieurs sont protégés contre l’éventuel comportement opportuniste des insiders, notamment des PDG. Enfin, les institutions du marché du travail affectent elles aussi l’avantage comparatif. Celles-ci comprennent les institutions déterminant la capacité d’une entreprise et de ses salariés à se lier par des contrats qui garantissent que ces derniers fournissent un niveau élevé d’efforts ou bien encore les institutions affectant les coûts d’embauche et de licenciement.
La causalité peut aller dans le sens inverse : le commerce international peut rétroagir sur les institutions domestiques en affectant la répartition de la richesse et du pouvoir au sein de l’économie. En l’occurrence, il enrichit certains groupes d’individus qui sont alors susceptibles d’obtenir suffisamment de pouvoir politique pour aiguillonner le changement institutionnel. Nunn et Trefler rappellent l’exemple savamment analysé par la littérature néo-institutionnelle, en l'occurrence le commerce triangulaire en Atlantique du dix-septième au dix-neuvième siècle (cf. notamment Acemoglu et alii, 2005). Ce commerce a enrichi une élite dans les plantations aux Caraïbes qui utilisa alors ses richesses pour évincer les travailleurs du pouvoir politique, de l’éducation et de l’accès aux biens publics. Il enrichit également en Europe une classe de marchands qui utilisèrent leurs richesses pour développer le système de droits de propriété qui se révéla favorable à la croissance économique. Enfin, en Afrique, la pratique de l’esclavage s’est traduite par une détérioration des institutions locales et des droits de propriété. La diversité des réponses institutionnelles au commerce international s’expliquerait par les caractéristiques des « exportations », donc de l’avantage comparatif initial.
Daniel Trefler, dans une étude co-réalisée avec Daniel Puga, avait poursuivi l’analyse en observant les effets du commerce international sur l’économie vénitienne entre 800 et 1350 [Puga et Trefler, 2013]. Au neuvième siècle, Venise devint politiquement indépendante. Son indépendance et sa position géographique privilégiée lui permirent de profiter de l'essor des relations commerciales entre l’Europe occidentale et l'Orient. Le développement, tout d’abord exogène, du commerce à longue distance enrichit un groupe de marchands qui utilisa ses nouvelles ressources pour renforcer les contraintes sur l’exécutif et notamment pour établir un parlement en 1172 qui devint par la suite l’ultime source de légitimité politique. Des innovations émergèrent dans les institutions contractuelles, afin de résoudre les problèmes liés aux rédactions de contrat à l’étranger, et catalysèrent ainsi la mobilisation du capital à grande échelle, ce qui permit un développement, cette fois-ci endogène, du commerce à longue distance. Ce dernier a donc tout d’abord stimulé le changement institutionnel et l’activité économique, mais pour ensuite les décourager. En effet, à partir de la fin du treizième siècle, un groupe de très riches marchands s’évertua à enrayer la concurrence dans le champ politique, en rendant la participation héréditaire, mais aussi dans le champ économique, en érigeant des barrières aux activités les plus lucratives du commerce à longue distance. Cette tentative de capture des rentes a finalement sapé le dynamisme institutionnel de Venise et fragilisé la cité médiévale face aux concurrents.
Références Martin ANOTA
ACEMOGLU, Daron, Simon JOHNSON & James ROBINSON (2005), « Institutions as the fundamental cause of long-run growth », in P. Aghion & Durlauf (dir.), Handbook of Economic Growth, Elsevier. Quelques extraits traduits ici.
NORTH, Douglas C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.
NUNN, Nathan, & Daniel TREFLER (2013), « Domestic institutions as a source of comparative advantage », NBER working paper, n° 18851, février.
PUGA, Diego, & Daniel TREFLER (2012), « International trade and institutional change: Medieval Venice's response to globalization », CEPR discussion paper, n° 9076, août.
commenter cet article …



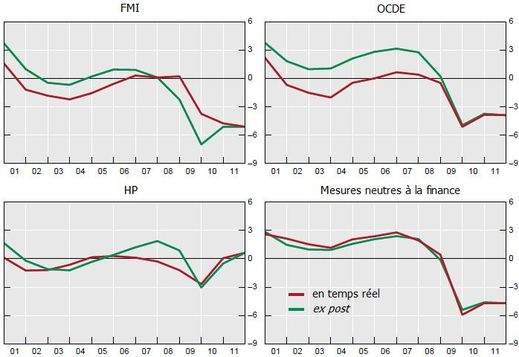



/image%2F1455320%2F20160828%2Fob_7355b6_jesse-pinkman-illusio-3.jpg)