Christiane Baumeister et Lutz Kilian (2016) ont passé en revue les causes des variations majeures des prix du pétrole au cours des quatre dernières décennies. Beaucoup d’auteurs, notamment James Hamilton (2003) ont expliqué ces variations comme résultant principalement des variations de l’offre de pétrole, provoquées notamment par des événements tels que les guerres et révolutions dans les pays-membres de l’OPEP. Lutz Kilian, à travers ses divers travaux et collaborations, a développé l’idée que plusieurs des épisodes de fortes fluctuations du prix du pétrole s’expliquaient en fait avant tout par les variations de la demande. En l’occurrence, une partie substantielle de la demande répond à un motif de consommation immédiate : lorsque l’économie mondiale connaît une expansion, la demande de matières premières, notamment de pétrole, augmente pour accroître la production de biens et services, poussant le prix des matières premières à la hausse ; réciproquement, un ralentissement de la croissance mondiale est susceptible de pousser les prix du pétrole à la baisse. Une partie de la demande répond aussi à la volonté d’accumuler des stocks et dépend alors des anticipations du prix du pétrole. Elle tend par exemple à augmenter dans l’anticipation de pénuries de pétrole dans le futur. Au cours de l’histoire, la demande au motif de stockage a été importante lorsque les tensions géopolitiques étaient fortes aux Moyen-Orient, lorsque les capacités de production étaient utilisées à leur maximum et lorsque les anticipations de croissance mondiale étaient très optimistes.
GRAPHIQUE Prix du pétrole brut WTI (en dollars 2015, ajusté en fonction de l’inflation)
source : Baumeister et Kilian (2016)
A première vue, le choc pétrolier de 1973-1974 semble être un choc d’offre négatif, comme l’affirme notamment Hamilton (2003). En effet, la quantité de pétrole brut produit chuta au dernier trimestre de l’année 1973. La guerre entre Israël et une coalition de pays arable entre le 6 et le 26 octobre de 1973 est souvent présentée comme étant la cause d’un tel choc d’offre. Pourtant, aucune installation de production pétrolière ne fut détruite par un quelconque conflit. Les pays arables de l’OPEP réduisirent délibérément leur production de pétrole de 5 % le 16 octobre 1973, puis de 25 % le 5 novembre, tout en accroissant le prix du pétrole. Ce dernier était alors basé sur la base de négociations entre les producteurs de pétrole et non par les marchés, si bien qu’il ne représente pas nécessairement le prix d’équilibre du marché. Plusieurs preuves empiriques suggèrent que les deux prix semblent toutefois très proches l’un de l’autre. Selon Kilian (2009), les chocs d’offre touchant la production de l’OPEP peuvent difficilement expliquer plus du quart de la hausse du prix du pétrole en 1973-1974 : cette dernière s’explique essentiellement par un choc de demande. La décision de l’OPEP de réduire la production et d’augmenter le prix était justifiée par la dévaluation du dollar, l’accélération non anticipée de l’inflation américaine et la forte demande de pétrole associée à la forte croissance économique.
Un second choc pétrolier eut lieu en 1979 : le prix du pétrole passa de 15 dollars en septembre 1978 à 40 dollars en avril 1980. Beaucoup, notamment Hamilton (2003), estimèrent que cette hausse s’explique par un choc d’offre, en l’occurrence par la réduction de la production iranienne suite à la Révolution iranienne. Barsky et Kilian (2002) ont douté de cette interprétation. En effet, les plus fortes contractions de la production iranienne eurent lieu en janvier et février 1979, mais le prix du pétrole ne varia pas significativement avant mai 1979. Kilian et Murphy (2014) acceptent toutefois l’idée que la Révolution iranienne se soit révélée importante en raison de son impact sur les anticipations du prix du pétrole : la demande de pétrole pour motif de stockage augmenta fortement, d’une part, en raison des craintes d’une aggravation des tensions entre l’Iran avec les Etats-Unis et ses voisins et, d’autre part, en raison des anticipations d’une forte croissance mondiale.
Après le pic atteint en avril 1980, le prix du pétrole chuta durablement, malgré l’éclatement de la guerre entre l’Irak et l’Iran. Le resserrement des politiques monétaires, dans le sillage du plan Volker, entraîna une récession mondiale et poussa par là même la demande de pétrole à la baisse. Cette chute fut amplifiée par les diverses mesures prises par les pays avancés en vue de réduire leur consommation de pétrole. Les perspectives d’une faible croissance mondiale désincita à accumuler et détenir des stocks de pétrole. Le niveau élevé des prix du pétrole à la fin des années soixante-dix avait en outre incité des pays n’appartenant pas à l’OPEP, notamment le Mexique, la Norvège et le Royaume-Uni, à accroître leur production domestique ou à devenir producteurs de pétrole ; le surcroît subséquent de production de pétrole contribua à la chute des cours.
Les membres de l’OPEP essayèrent collectivement de contrer cette baisse du prix en s’accordant à restreindre leur production, mais chacun d’entre eux était incité à ne pas respecter cet accord et à accroître son offre. L’Arabie saoudite décida de stabiliser par elle-même le prix du pétrole en réduisant sa production, mais sa tentative échoua : le prix du pétrole continua de chuter au début des années quatre-vingt. Les pertes en termes de recettes tirés du pétrole furent si importantes que l’Arabie saoudite fut obligée à la fin de l’année 1985 d’inverser sa politique. Le prix du pétrole chuta brutalement en 1986, en raison de la reprise de la production saoudienne et de la demande de stockage de pétrole.
La guerre entre l’Iran et l’Irak a eu peu de répercussions sur le prix du pétrole au cours des années quatre-vingt, en raison de la relative abondance de l’offre mondiale de pétrole. L’invasion du Koweït en 1990 fut toutefois suivie d’une forte hausse du prix du pétrole. Cette dernière s’explique non seulement par les perturbations que ce conflit entraîna sur les productions iraquienne et koweitienne, mais aussi par la plus forte demande de pétrole pour des motifs de stockage, dans l’anticipation d’une possible attaque menée contre les champs de pétrole saoudiens. Ce n’est qu’à la fin de l’année 1990, lorsque la collation menée par les Etats-Unis plaça suffisamment de troupes sur le sol saoudien pour empêcher toute invasion de l’Arabie saoudite, que ces craintes se dissipèrent et que le prix du pétrole chuta.
Le prix du pétrole s’affaiblit davantage à la fin des années quatre-vingt-dix et atteint les 11 dollars en décembre 1998, en raison d’une moindre demande de pétrole, très certainement provoquée par la crise asiatique de 1997 et sa transmission à plusieurs pays émergents. Le prix du pétrole repartit à la hausse en 1999, en raison de la plus forte demande de pétrole associée à la reprise mondiale, de quelques contractions de la production et d’une plus grande demande de pétrole au motif de stockage dans l’anticipation de futures tensions sur le marché du pétrole. La production de pétrole connut effectivement deux perturbations majeures fin 2002 et début 2003 : la chute de la production vénézuélienne associée aux troubles civiles au Venezuela et les perturbations générées par la Guerre d’Irak en 2003. La contraction des productions vénézuélienne et irakienne fut toutefois compensée par une hausse de la production dans le reste du monde. Au final, le prix du pétrole s’est alors révélé remarquablement stable malgré les troubles géopolitiques.
La hausse du prix du pétrole entre le milieu de l’année 2003 et le milieu de l’année 2008 est la plus forte que l’économie mondiale ait connu depuis celle de 1979. Le prix du pétrole WTI est passé de 28 à 134 dollars. Il y a un assez large accord autour de l’idée que cette hausse ne s’explique pas par des perturbations du côté de l’offre, mais par la hausse de la demande de pétrole. Beaucoup ont affirmé que l’accroissement de la demande résultait de l’expansion non anticipée de l’économie mondiale et notamment d’un accroissement de la demande en provenance des pays émergents d’Asie. Certains ont toutefois suggéré que cette hausse du prix du pétrole sur le marché physique s’expliquait essentiellement par les positions spéculatives prises par les traders sur les marchés à terme du pétrole. Bassam Fattouh et alii (2013) jugent toutefois qu’aucune preuve empirique ne confirme cette interprétation alternative.
La crise financière mondiale et la reprise subséquente ont également illustré l’impact de la demande sur le prix du pétrole. Comme les commandes de biens industriels chutèrent fortement dans la seconde moitié de l’année 2008 avec l’anticipation d’une récession mondiale, la demande pour les matières premières chuta également et le prix du pétrole passa de 134 à 39 dollars entre juin 2008 et février 2009. Lorsque la reprise mondiale s’amorça en 2009 et que les craintes d’un écroulement du système financier mondial s’essoufflèrent, la demande de pétrole retrouva ses niveaux de 2007 et le prix du pétrole WTI se stabilisa autour de 100 dollars.
Entre juin 2014 et janvier 2015, le prix du pétrole Brent passa de 112 à 47 dollars. Baumeister et Kilian (2015) ont analysé la chute de 49 dollars du prix entre juin 2014 et décembre 2014. Ils estiment que deux chocs survenus avant juin 2014 expliquent 55 % de cette chute : le déclin de l’activité économique et l’accroissement de la production en expliquent réciproquement 22 % et 33 %. Le reste s’explique par deux chocs survenus au cours de la seconde moitié de 2014 : la prise de conscience d’un ralentissement de la croissance plus marqué que prévu et la réduction de la demande au motif de stockage expliquent réciproquement 18 et 27 % de la chute du prix du pétrole.
Références
HAMILTON, James D. (2003), « What is an Oil Shock? », in Journal of Econometrics, vol. 113, n° 2.
KILIAN, Lutz (2009), « Comment on ‘Causes and consequences of the oil shock of 2007-08’ by James D. Hamilton », in Brookings Papers on Economic Activity.
KILIAN, Lutz, & Daniel P. MURPHY (2014), « The role of inventories and speculative trading in the global market for crude oil », in Journal of Applied Econometrics, vol. 29, n° 3.






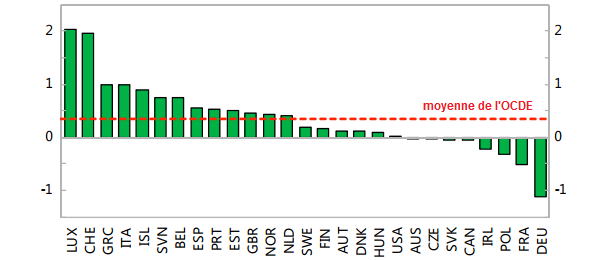
/image%2F1455320%2F20160828%2Fob_7355b6_jesse-pinkman-illusio-3.jpg)