Entre 2005 et 2015, la croissance de la productivité du travail a atteint en moyenne 1,3 % par an aux Etats-Unis, contre 2,8 % sur la période comprise entre 1995 et 2004. A long terme, cette différence se traduit par une perte substantielle en termes de niveau de vie pour les Américains. En effet, si la croissance de la productivité n’avait pas ralenti et s’était poursuivie au même rythme, alors le PIB américain à la fin de l’année 2015 aurait été supérieur de 15 % au niveau qu’il atteint [Syverson, 2016]. Cette « perte » s’élève à 2.700 milliards de dollars pour l’ensemble de l’économie et à 8.400 dollars pour chaque Américain. Si la croissance de la productivité du travail se maintenait à 1,3 % pendant 25 ans, le revenu par tête qui serait atteint en fin de période serait inférieur de 45 % au niveau qu’il aurait atteint si la croissance de la productivité du travail s’était maintenue à 2,8 %.
Diverses études ont cherché à décrire ce ralentissement. Plusieurs d’entre elles suggèrent qu’il n’est pas (uniquement) dû à des phénomènes conjoncturels. John Fernald (2014) a en effet montré qu’il s’est amorcé avant le début de la Grande Récession et qu’il ne s’explique pas par d’éventuelles bulles qui se seraient formées dans le secteur immobilier ou le système financier. Tout comme David Byrne, Stephen Oliner et Daniel Sichel (2013), il relie le ralentissement de la croissance de la productivité au ralentissement de la productivité dans l’industrie et au tarissement des gains de productivité associés à la diffusion des nouvelles technologies d’information et de communication entre 1995 et 2004.
Le débat s’est cristallisé sur les causes et la durée de ce ralentissement. Pour certains, profondément pessimistes, la croissance de la productivité est promise à rester lente ces prochaines décennies. Pour Robert Gordon (2012), c’est l’accélération observée entre 1995 et 2004 qui apparaît exceptionnelle : la croissance de la productivité a simplement retrouvé après 2004 le rythme auquel elle se maintenait dans les décennies qui ont précédé 1995. Le développement et la diffusion des technologies d’information et de communication a certes permis de stimuler la croissance de la productivité, mais leur potentiel était initialement plus faible que celui des vagues d’innovations que les Etats-Unis ont pu connaître par le passé. Certaines raisons amènent d’autres à rester optimiste. Par exemple, Martin Neil Baily, James Manyika et Shalabh Gupta (2013) estiment qu’il demeure des opportunités d’innovation dans plusieurs secteurs de l’économie américaine. De son côté, Chad Syverson (2013) note que les gains de la productivité associés à l’électrification et au moteur à combustion interne se sont manifestés par vagues, ce qui suggère que les gains de productivité associés aux nouvelles technologies d’information et de communication ne se sont pas peut-être entièrement matérialisés entre 1995 et 2004 et qu’une nouvelle vague d’accélération de la productivité pourrait ainsi s’amorcer à moyen terme.
Divers auteurs ont toutefois suggéré que le ralentissement de la croissance de la productivité est, pour une grande part, illusoire. En l’occurrence, les récents gains de productivité ne se seraient pas pleinement reflétés dans les statistiques, si bien que la véritable croissance de la productivité depuis 2004 n’a pas ralenti autant que ne le suggèrent les chiffres et qu’elle pourrait même s’être accélérée. Cette sous-estimation de la croissance de la productivité s’expliquerait notamment par le fait que les chiffres de la productivité ne parviennent pas à capturer la réelle valeur des innovations. Par exemple, plusieurs des innovations de la dernière décennie, notamment les services en ligne, sont disponibles gratuitement ou, tout du moins, à de faibles prix, si bien que leur prix n’indiquerait pas pleinement l’utilité qu’en retirent les utilisateurs.
Chad Syverson (2016) remet en question cette hypothèse en avançant quatre arguments. Premièrement, la croissance de la productivité a ralenti dans une douzaine de pays avancés. Si ce ralentissement s’expliquait par l’incapacité des statistiques à pleinement saisir la valeur des technologies d’information et de communication, alors il serait davantage marqué dans les pays qui produisent ou consomment le plus de ces technologies. Or Syverson ne constate aucun lien statistique entre l’ampleur du ralentissement de la croissance de la productivité et les indicateurs de consommation et de production de technologies d’information et de communication. Cette conclusion rejoint l’une des observations de Roberto Cardarelli et Lusine Lusinyan (2015).
Deuxièmement, plusieurs études ont cherché à estimer le gain que la diffusion des technologies numériques a pu générer en termes de surplus des consommateurs. Or les estimations auxquelles elles aboutissent suggèrent un gain en termes de surplus des consommateurs bien inférieur aux 2.700 milliards de dollars de « production manquante » qui résulte du ralentissement de la croissance de la productivité. Les estimations les plus optimistes suggèrent un gain en termes de surplus des consommateurs représentant moins d’un tiers de cette production manquante.
Troisièmement, Syverson observe les contributions des différents secteurs au PIB américain pour déterminer de combien leur valeur ajoutée aurait dû augmenter pour que l’hypothèse d’une mauvaise mesure de la productivité tienne. Pour expliquer ne serait-ce qu’un tiers de la production manquante, il aurait fallu que la valeur ajoutée des secteurs associés à internet s’accroisse de 170 % entre 2004 et 2015, soit trois fois plus amplement qu’elle n’a augmenté selon les statistiques.
Quatrièmement, Syverson observe les différences entre le PIB et le revenu intérieur brut ; le premier correspond à la somme des valeurs ajoutées et le second à la somme des revenus versés. Si les deux agrégats se mesurent différemment, leurs valeurs devraient en principe coïncider. Or, pendant plusieurs années, le revenu intérieur brut a été supérieur au PIB, ce qui pourrait suggérer que des travailleurs seraient peut-être payés pour produire des biens et services consommés (quasi) gratuitement et que le PIB ne capte pas entièrement les gains associés aux nouvelles technologies d’information et de communication. Syverson note toutefois que la différence entre les deux agrégats apparaît en 1998, c’est-à-dire précisément au début de l’accélération de la productivité américaine, et qu’elle s’explique essentiellement par des profits inhabituellement élevés. Ces quatre constats l’amène alors à rejeter l’hypothèse que le ralentissement de la croissance de la productivité américaine soit apparent.
Références





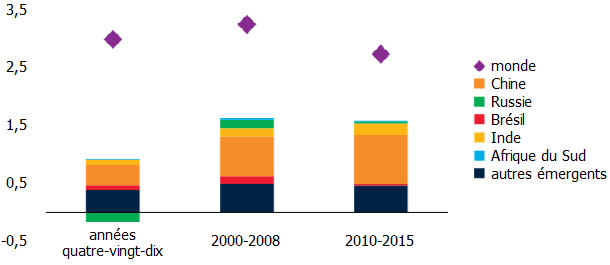
/image%2F1455320%2F20160828%2Fob_7355b6_jesse-pinkman-illusio-3.jpg)