Beaucoup considèrent la déflation comme le symptôme d’une insuffisance de la demande globale : les entreprises baissent leurs prix, car elles ont du mal à écouler leurs stocks. Dans ce cas, la déflation indiquerait une baisse simultanée et cumulative des prix, de la production et des revenus. Pourtant, elle peut aussi provenir d’un accroissement de l’offre globale, par exemple sous l’effet du progrès technique, de l’intensification de la concurrence ou de l’abondance d’intrants moins chers (notamment du pétrole). Dans ce cas, la déflation pourrait au contraire signaler une hausse des revenus et de la production.
Claudio Borio, Magdalena Erdem, Andrew Filardo et Boris Hofmann (2015) considèrent en outre que les répercussions de la déflation sont ambigües, ne serait-ce qu'au regard de la théorie. Si elle résulte d’une insuffisance de la demande globale, la déflation peut contribuer à aggraver celle-ci. Les ménages et les entreprises pourraient en effet avoir tendance à repousser leurs achats de biens durables s’ils anticipent une poursuite de la baisse des prix. En outre, la déflation accroît la valeur réelle de la dette, ce qui dégrade la situation financière des emprunteurs et conduit ces derniers à restreindre leurs dépenses et de nouveau à baisser leurs prix en vue de se désendetter ; ce processus de déflation par la dette (debt-deflation) identifié par Irving Fisher (1933) conduirait non seulement à amplifier la contraction de la demande, mais fragiliserait également l’ensemble du système bancaire. Si les taux d’intérêt nominaux butent sur leur borne inférieure zéro (zero lower bound), la banque centrale pourra difficilement encourager les dépenses, si bien que sa politique monétaire se révélera excessivement restrictive.
D’un autre côté, Borio et ses coauteurs estiment que la déflation peut contribuer, du moins théoriquement, à accroître la production. En effet, elle permet aux entreprises d’avoir accès à des intrants moins chers. En outre, elle incite les ménages à davantage consommer en accroissant leur pouvoir d’achat et en générant des effets de richesse avec l’accroissement de leur patrimoine réel. Enfin, lorsqu’une seule économie est en déflation, la baisse des prix domestiques stimule la demande extérieure en rendant les produits domestiques plus compétitifs sur les marchés internationaux. Par contre, les effets de la déflation des prix des actifs sont moins ambigus : Elle érode le patrimoine et la valeur des collatéraux, si bien qu’elle érode la situation financière des agents et les incite à réduire leurs dépenses en raison des effets de richesse négatifs.
Borio et ses coauteurs testent le lien historique entre la croissance de la production et la déflation dans un échantillon couvrant 140 années pour 38 économies. Ils confirment le fait que les déflations survenaient régulièrement avant la Seconde Guerre mondiale. Seuls quatre épisodes de déflation persistante ont eu lieu après celle-ci, en l’occurrence au Japon (par deux fois), en Chine et à Hong-Kong. Par contre, il y a eu plusieurs épisodes momentanés de déflation durant l’après-guerre. Les déflations étaient bien plus intenses avant la Seconde Guerre mondiale qu’après celle-ci, que ce soit en termes de variation des prix qu’en termes de durée.
Les déflations ont pu aussi bien coïncider avec des périodes de croissance positive qu’avec des périodes de croissance négative. En moyenne, la croissance n’a été qu’à peine plus élevée durant les phases d’inflation que durant les phases de déflation. L’analyse empirique suggère que le lien entre croissance et déflation est faible et qu’il s’explique essentiellement par l’épisode de la Grande Dépression : au cours des années trente, il y a en effet eu une corrélation entre la déflation et la croissance. Après la Seconde Guerre mondiale, le taux de croissance du PIB a été de 3,2% durant les périodes de déflation contre 2,7 % le reste du temps. Par contre, Borio et ses coauteurs constatent un lien bien plus significatif entre la croissance de la production et la déflation des prix d’actifs, en particulier lors des épisodes de baisse des prix de la propriété durant l’après-guerre. Borio et ses coauteurs prennent alors en compte l’endettement public et privé. Ils échouent à mettre en évidence la présence de mécanismes de déflation par la dette, puisque leur analyse ne démontre pas que les dommages associés à la baisse des prix des biens et services soient plus élevés lorsque le secteur privé est fortement endetté. Par contre, la baisse des prix de la propriété semble nuire davantage à l’activité lorsqu’elle s’opère dans un contexte de fort endettement privé.
La récente expérience japonaise tendrait à confirmer les résultats de Borio et de ses coauteurs. L’économie insulaire a en effet connu à partir de la fin des années quatre-vingt-dix l’épisode déflationniste le plus persistant de l’après-guerre. Entre 1998 et 2010, les prix ont connu une chute totale de 4 %. Cette déflation persistante fait suite à l’éclatement de bulles boursière et immobilière au début des années quatre-vingt-dix, qui faisait lui-même suite à une forte expansion des prix d’actifs et du crédit à la fin des années quatre-vingt. Puisque le Japon n’a jamais renoué avec le rythme de croissance qu’il atteignait avant qu’éclatent les bulles, beaucoup ont parlé de « deux décennies perdues ». Borio et ses coauteurs rejettent cette idée en prenant en compte les évolutions démographiques du Japon. Si effectivement la croissance annuelle du PIB réel par tête a fortement ralenti durant les années quatre-vingt-dix, elle a par contre accéléré durant les années deux mille. Entre 1991 et 2000, le PIB réel par tête a augmenté de 6 % au Japon, contre 26 % aux Etats-Unis. Entre 2000 et 2013, il a augmenté de 10 % au Japon, contre 12 % aux Etats-Unis. Sur la même période, le PIB réel par habitant en âge de travailler a même augmenté de plus de 20 % au Japon, contre environ 11 % aux Etats-Unis.
Au final, ces résultats amènent Borio et ses coauteurs à mettre en doute l’idée généralement acceptée que la déflation, même lorsqu’elle persiste, soit forcément nocive à l’activité économique et à la stabilité financière.
Références
FISHER, Irving (1933), « The debt deflation theory of great depressions », in Econometrica, vol. 1, n° 4. Traduction française, « La théorie des grandes dépressions par la dette et la déflation », in Revue française d’économie, vol. 3, n°3, 1988.






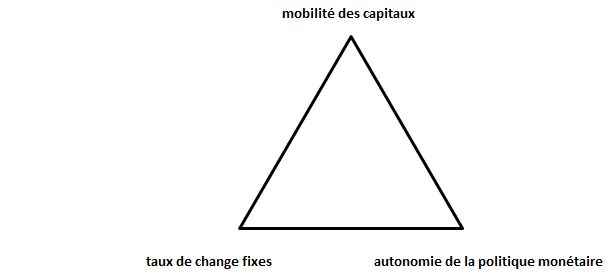

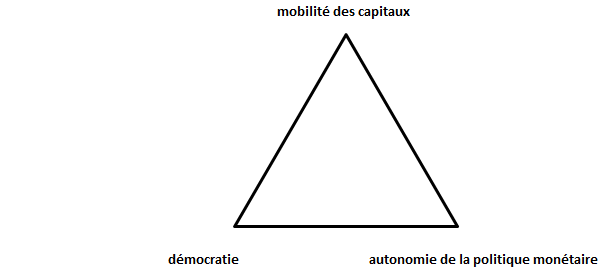

/image%2F1455320%2F20160828%2Fob_7355b6_jesse-pinkman-illusio-3.jpg)