Dans le sillage des travaux des monétaristes, puis des nouveaux classiques, la théorie orthodoxe a longuement considéré que la politique monétaire était neutre à long terme. S’il y avait débat, celui-ci portait sur les effets de la politique monétaire à court terme : à court terme, elle est active pour les monétaristes et les nouveaux keynésiens, mais neutre pour les nouveaux classiques. Dans leur raisonnement, la politique monétaire n’est supposée avoir d’effet que sur la demande globale, si bien qu’elle influence peut-être le cycle d’affaires, mais non la production à long terme ; cette dernière est supposée être déterminée par des facteurs structurels comme la technologie, la démographie et les préférences des agents. Par conséquent, les banques centrales ont peut-être la capacité d'écourter les épisodes de récession en ramenant plus vite la production sur sa trajectoire de long terme, elles n'ont pas la capacité d'affecter cette trajectoire.
Si les monétaristes et les nouveaux classiques partagent la même vision du long terme, c'est notamment parce qu'ils ont adopté la théorie quantitative de la monnaie : selon cette dernière, un assouplissement monétaire entraîne mécaniquement une hausse du niveau des prix. Mais son impact exact sur l'activité à court terme dépend de la nature des anticipations. Si les anticipations sont adaptatives, alors les agents vont dans un premier temps sous-estimer l’inflation courante [Friedman, 1958]. Les salaires réels vont alors diminuer, ce qui va inciter les entreprises à embaucher, si bien que le chômage va diminuer et la production augmenter. Mais, dans un deuxième temps, les travailleurs vont corriger leurs erreurs d’anticipations et exiger une hausse de leurs salaires nominaux, ce qui va inciter les entreprises à licencier et entraîner une baisse de la production : les salaires réels, le chômage et l'activité reviennent alors à leur niveau initial. Mais si les anticipations sont rationnelles, comme le supposent les nouveaux classiques, alors la politique monétaire perd toute capacité à influencer la production et l'emploi : si la banque centrale adopte une politique monétaire accommodante, les agents révisent immédiatement leurs anticipations, si bien qu’ils ne modifient pas leurs comportements en termes de travail et de production [Sargent et Wallace, 1975].
Les nouveaux keynésiens ont répliqué aux nouveaux classiques en montrant que l’hypothèse d’anticipations rationnelles n’impliquait pas forcément une neutralité de la politique monétaire à court terme : cette dernière influence l’activité et le chômage à court terme si les prix et salaires sont visqueux. En l’occurrence, si la banque centrale assouplit sa politique monétaire, la demande globale augmente, ce qui stimule l'activité et réduit le chômage. Mais si la viscosité des prix et salaires les empêche de s’ajuster à court terme, ils s’ajusteront tout de même à long terme : l’assouplissement monétaire entraîne en définitive une hausse des prix, ce qui ramène la demande et donc la production et l'emploi à leur trajectoire initiale. Ainsi, les monétaristes, les nouveaux classiques et les nouveaux keynésiens ne s’accordent pas sur l’effet de la politique monétaire sur l’activité à court terme, mais ils se rejoignent en concluant qu’elle n’influence pas l’activité à long terme.
Depuis les années quatre-vingt, certains nouveaux keynésiens ont toutefois parlé d’effets d’« hystérèse » (ou d’« hystérésis ») en évoquant la possibilité que le niveau de production (et du chômage) à long terme soit influencé par la conjoncture, c’est-à-dire finalement par la demande globale. Ces travaux font souvent transiter ces effets d’hystérèse par le marché du travail ; c’est notamment le cas d’Olivier Blanchard et Larry Summers (1986), de Jordi Galí (2015) ou encore d’Olivier Blanchard (2018). Par exemple, plus les chômeurs passent du temps au chômage, plus ils perdent en compétences et voient leur santé se dégrader, moins ils ont de chances d’être embauchés rapidement, plus ils risquent de se décourager et de quitter la vie active. Autrement dit, plus le taux de chômage persiste à un niveau élevé, plus il risque d’être élevé à long terme et plus le potentiel de croissance s’en trouve dégradé. C’est un tel raisonnement qui amène à plaider en faveur de l’usage agressif de politiques expansionnistes lorsque l’économie bascule dans la récession : plus vite l’économie est ramenée au plein emploi, moins les effets d’hystérèse auront l’occasion de se manifester.
Plusieurs travaux empiriques réalisés ces deux dernières décennies ont confirmé que le niveau de production à long terme était influencé par la conjoncture et, notamment pour cette raison, par les politiques conjoncturelles : par exemple, Valerie Cerra et Sweta Saxena (2008, 2017) ont montré que les récessions entraînaient une perte du production permanente, même lorsqu’elles ne sont pas synchrones avec une crise financière, tandis qu’Antonio Fatás et Larry Summers (2017) ont mis en évidence les dommages permanents des plans d’austérités sur la production potentielle. De tels travaux pourraient ainsi suggérer que la politique monétaire est susceptible d'avoir des effets sur l'activité à long terme. Pourtant, la littérature peine à le montrer.
Plusieurs études empiriques, souvent focalisées sur l’économie américaine, ont précisément cherché à déterminer si la politique monétaire était active ou neutre à long terme [James Bullard, 1999]. Mark Fisher et John Seater (1993) estiment que les données permettent de rejeter l’idée d’une neutralité à long terme, mais John Boschen et Christopher Otrok (1994) notent que leurs résultats sont moins robustes lorsque l’épisode de la Grande Dépression des années trente est écarté de l’échantillon. La très grande majorité des études concluent plutôt que les données sont cohérentes avec une neutralité à long terme, mais la plupart d’entre elles, notamment celle de Robert King et Mark Watson (1997), partent de l’idée que la banque centrale contrôle l’offre de monnaie, si bien que ces analyses concluent en définitive davantage en la neutralité des agrégats monétaires à long terme, plutôt qu’en la neutralité de la politique monétaire proprement dite. Les analyses de Ben Bernanke et Ilian Mihov (1998) et de Yunus Aksoy et Miguel León-Ledesma (2005) font exception en partant du fait que la banque centrale contrôle les taux d’intérêt nominaux de court terme.
Attaquant la question sous un autre angle que le faisait la littérature existante, Òscar Jordà, Sanjay Singh et Alan Taylor (2020) se sont demandé si la politique monétaire influençait la capacité productive de l’économie à long terme en étudiant 125 années de données relatives à 17 pays développés. Pour observer les effets propres à la politique monétaire, ils ont cherché à identifier des variations exogènes des taux d’intérêt. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur le trilemme de la finance internationale : quand un pays ancre sa monnaie sur la devise d’un autre pays, en retirant toute barrière aux mouvements de capitaux, il perd le contrôle de son taux d’intérêt domestique. Les chocs touchant les taux d’intérêt dans le pays dont la monnaie sert de devise d’ancrage sont alors exogènes pour les taux d’intérêt domestiques.
Une fois les chocs de politique monétaire identifiés, Jordà et ses coauteurs en observent les effets. Ils notent alors la présence de puissantes forces d’hystérèse : en réponse à un resserrement monétaire, la production décline et, plus d’une décennie après, elle n’est toujours pas retournée à la tendance qu’elle suivait avant le choc. En effet, une hausse d’un point de pourcentage des taux d’intérêt de court terme se traduit par un PIB inférieur de plus de 3 % douze ans après. En conclusion, il apparaît que la monnaie est active bien plus longtemps que ce qui est souvent supposé, ce qui amène à rejeter l’idée d’une neutralité monétaire à long terme.
Lorsqu’ils cherchent à déceler la source de cet effet d’hystérèse, Jordà et ses coauteurs constatent que ce dernier touche le stock de capital et la productivité totale des facteurs, mais non le travail. En effet, le capital et la productivité globale des facteurs connaissent des trajectoires similaires à la production ; à l’inverse, le nombre d’heures travaillées, le nombre d’heures par travailleur et le nombre de travailleurs retournent rapidement à la tendance qu’ils suivaient avant le choc. L’effet d’hystérèse que leur analyse met en évidence n’est donc pas le même que celui habituellement retenu dans la littérature. Dans la modélisation qu’ils proposent alors, le choc de politique monétaire réduit la production et freine temporairement la croissance de la productivité globale des facteurs. Mais ce ralentissement a beau être temporaire, le capital et la production se retrouvent sur une trajectoire tendancielle inférieure à celle qu’ils suivaient avant le choc monétaire : une faiblesse des débouchés incite ou force certainement les entreprises à moins investir, mais le retour ultérieur de la demande ne va pas pour autant les amener à lancer les projets d'investissement qu'elles n'ont voulu ou qu'elles n'ont pu réaliser.
Une telle étude confirme qu'il est nécessaire que les banques centrales réagissent aux contractions de l'activité en assouplissant leur politique monétaire. En l'occurrence, elles doivent le faire rapidement et agressivement pour éviter que des effets d'hystérèse se manifestent et réduisent le potentiel de croissance de l'économie à long terme. Réciproquement, il apparaît justifié que les banques centrales ne resserrent pas trop rapidement leur politique monétaire lorsque l'économie renoue avec l'expansion ; la laisser en légère surchauffe pourrait peut-être même contribuer à relever le potentiel de croissance à long terme.
Références





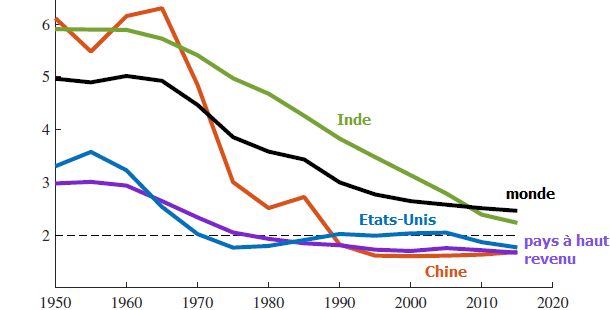


/image%2F1455320%2F20160828%2Fob_7355b6_jesse-pinkman-illusio-3.jpg)